Tag : Afrique
 Publié 23 Mars 2024
Publié 23 Mars 2024Chine : marginaliser le cantonais pour mieux régner
Préserver la diversité linguistique au sud de la Chine, à Hong Kong, Macao et dans la province de Canton, n'est pas vraiment dans les plans du pouvoir central. Cela fait deux décennies que le cantonais, une des spécificités régionales, est dans le viseur du gouvernement. Depuis fin 2016, diminuer son usage à Hong Kong fait partie intégrante du projet d’unification par la langue au cœur de la "Grande Baie", cette mégalopole de 70 millions d'âmes conçue par Pékin pour fondre l'ancienne colonie britannique dans le Guangdong.
 Publié 27 Mai 2023
Publié 27 Mai 2023La Chine et la dette des pays pauvres : l’heure de vérité
Le choc de la pandémie, puis celui de la guerre en Ukraine, et la hausse rapide des taux d’intérêt ont placé plus de soixante-dix pays en développement dans une situation de tension, voire de crise ouverte sur la gestion de leur dette. La Chine est devenue, après une décennie de développement des programmes des "Nouvelles routes de la soie", le premier créancier des pays pauvres, sans pour autant faire partie du Club de Paris qui est l’organe multilatéral de traitement des dettes publiques. Elle ne peut plus se contenter de gérer les problèmes bilatéralement au coup par coup. Mais aucun consensus n’existe sur la méthode entre Chine, FMI et Club de Paris. L’année 2023 sera cruciale pour mettre en place ce consensus, et pour éviter une nouvelle crise mondiale de la dette.
 Publié 03 Août 2022
Publié 03 Août 2022Hommage à Jean-Raphaël Chaponnière, spécialiste des économies asiatiques
Jean-Raphaël Chaponnière nous a quittés le 25 juillet à l'âge de 76 ans, après un long combat contre la maladie. Il comptait parmi les meilleurs spécialistes français des économies asiatiques et de la mondialisation. Il avait rejoint Asialyst en 2015, pour devenir très rapidement l’un des piliers de notre équipe.
 Publié 14 Janvier 2022
Publié 14 Janvier 2022La Chine récuse tout "piège de la dette" en Afrique comme en Asie du Sud
Du 4 au 10 janvier derniers, le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, s’est fendu d’un long périple sur les rives de l’océan Indien. Un voyage organisé en cinq escales concises réparties entre destinations est-africaines et capitales sud-asiatiques. Pour le ministre chinois, "le soi-disant "piège de la dette" est en fait un piège narratif créé par celles et ceux souhaitant plonger à jamais l'Afrique dans un "piège de la pauvreté" et un "piège du retard" [de développement]".
 Publié 04 Décembre 2021
Publié 04 Décembre 2021Le "portail mondial" de l'Europe peut-il faire le poids contre les "Nouvelles routes de la soie" ?
Peut-il vraiment concurrencer le projet pharaonique de la Chine ? Ce mercredi 1er décembre, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé un programme doté de 300 milliards d’euros visant à contrer les "Nouvelles routes de la soie" lancées par Xi Jinping en 2013. L'UE veut mobiliser cet argent pour financer des infrastructures physiques permettant de renforcer les réseaux numériques, de transport et d’énergie, pour l'essentiel.
 Publié 28 Mai 2021
Publié 28 Mai 2021Covid-19 : en solo, la Chine fournit 70 % des vaccins pour les pays en développement
La Chine est aujourd’hui, avec les trois vaccins qu’elle exporte, le premier fournisseur des pays en développement : plus de 700 millions de doses promises et 231 millions déjà fournies. Pour autant, la contribution chinoise à l’effort multilatéral engagé par l’OMS avec la facilité Covax est modeste. La Chine vient certes d‘annoncer qu’elle fournira à Covax 10 millions de doses du vaccin Sinopharm qui vient d’être homologué par l’OMS. Mais elle n’apporte aucune contribution financière alors que les engagements occidentaux s’élèvent à 9 milliards de dollars. L’Asie dans son ensemble joue d’ailleurs très peu la carte multilatérale à l’exception du Japon.
 Publié 04 Février 2021
Publié 04 Février 2021Chine-Ghana : une relation douce-amère sous la plume du caricaturiste Bright Ackwerh
Le Ghana est l'un des partenaires-clés des "Nouvelles Routes de la Soie", le projet pharaonique de la Chine. Depuis 2017, ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest tente de s'émanciper de l’aide économique du FMI, alors même que sa dépendance à l'égard de Pékin ne fait que s'aggraver. Le paradoxe n'a pas échappé à l'artiste ghanéen Bright Ackwerh qui croque, dans ses caricatures, un Xi Jinping avide et un Nana Akufo-Addo complaisant.
 Publié 14 Mars 2020
Publié 14 Mars 2020Quand l'histoire bégaie : le Japon en Afrique au début du XXe siècle
La Chine fait aujourd'hui partie du paysage africain. Les réactions à son irruption dès les années 1950 rappellent celles qu'avait suscitées la percée du Japon sur le continent noir un siècle auparavant.
 Publié 05 Octobre 2019
Publié 05 Octobre 2019La Chine maritime et navale (4/7) : 70 ans et la marine enfin au cœur de la puissance
Aujourd'hui, la mer occupe enfin une place centrale inédite dans les objectifs de défense de la Chine populaire, qui a fêté ses 70 ans le 1er octobre dernier. Elle est maintenant presque liée à son identité de grande puissance, celle qu'elle projette à l'intérieur du pays et à l'extérieur.
 Publié 02 Octobre 2019
Publié 02 Octobre 2019La Chine maritime et navale (2/7) : avant Zheng He, les Austronésiens à la barre
Les grandes expéditions de l'amiral Zheng He nous le font oublier : la Chine s'est lancée tardivement dans la navigation en haute mer. La plus ancienne preuve connue à ce jour d'une présence navale chinoise en Asie du Sud-Est date de la fin du XIIIème siècle, avec l'envoi en 1292 d'une flotte à Java par l'empereur Kubilai Khan. Un corps expéditionnaire de dix mille hommes montés sur un millier de bateaux qui subit un échec devant les troupes javanaises.
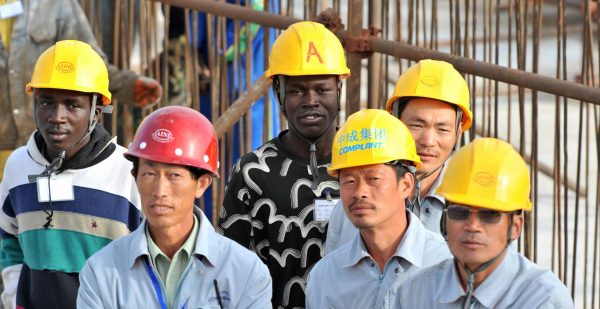 Publié 04 Septembre 2018
Publié 04 Septembre 2018La Chine n'est pas responsable de la désindustrialisation de l’Afrique
La Chine est accusée d'avoir désindustrialisé l'Afrique, où ses exportations ont ruiné des artisans et des petites entreprises. Mais les statistiques montrent que la désindustrialisation du continent a précédé l'irruption des produits chinois.
 Publié 21 Novembre 2017
Publié 21 Novembre 2017"Make in India" : la peur du vide
Comment l'Inde de Modi peut-elle tenir ses promesses de relancer l'industrie et l'investissement ? Quelle stratégie entre l'innovation frugale et la R&D ?
 Publié 14 Août 2017
Publié 14 Août 2017Quand la Chine construit des trains en Afrique : le précédent du Tazara
Au début des années 1970, la Chine a construit une train reliant la Tanzanie à la Zambie. Le "Tazara" reste son plus grand projet en Afrique.
 Publié 12 Juin 2017
Publié 12 Juin 2017La relation entre la Chine et le Congo n’est pas gouvernementale
Les relations sino-congolaises doivent passer par les gouvernements, selon Cinardo Kivuila, directeur de l’agence de communication Médias Business Congo.
 Publié 14 Décembre 2016
Publié 14 Décembre 2016Madagascar : une nouvelle exploitation aurifère chinoise dans la tourmente
Une exploitation aurifère en lien avec des exploitants chinois fait polémique à Madagascar.
 Publié 10 Novembre 2016
Publié 10 Novembre 2016Michaëlle Jean : « La Francophonie comme pont entre l'Asie et l'Afrique »
Et si la Francophonie, c’était d’abord de l’économie et une plate-forme d’échange entre l’Asie et l’Afrique ?
 Publié 25 Octobre 2016
Publié 25 Octobre 2016Chine - Afrique : aplanir les différences dans le commerce en jouant les "pare-chocs culturels"
Jilles Djon est le créateur de la Chambre de commerce africaine en Chine. Il raconte son expérience du terrain.
 Publié 19 Octobre 2016
Publié 19 Octobre 2016« Les opérateurs chinois à Madagascar sont perçus comme des délinquants »
L'activiste malgache Mbolatiana Raveloarimisa dénonce les exactions commises par les entreprises étrangères, et notamment chinoises.
 Publié 28 Septembre 2016
Publié 28 Septembre 2016Le Japon veut sa place en Afrique
Comment comprendre le nouveau "pivot japonais" vers l'Afrique ? D'autant que Tokyo y investit depuis longtemps. Analyse.
 Publié 11 Avril 2016
Publié 11 Avril 2016La Chine se rappelle au bon souvenir de la "diplomatie du chéquier"
Le passage de la Gambie du giron taïwanais au giron chinois prouve que Pékin sait toujours manier la "diplomatie du chéquier".
 Publié 08 Décembre 2015
Publié 08 Décembre 2015Chine-Afrique : la fin du "gagnant-gagnant"
Si les échanges ont triplé depuis 2006, les pays africains sont aujourd’hui déficitaires dans leur commerce avec la Chine.
 Publié 17 Novembre 2015
Publié 17 Novembre 2015Inde : besoin d’Afrique
La politique africaine de l’Inde a connu un nouvel essor ces dernières années, mais elle reste encore loin des investissements chinois.
 Publié 28 Octobre 2015
Publié 28 Octobre 2015L’Afrique, le défi de la criminologie taïwanaise
A Taïwan, l’Afrique est pensée avant tout comme un sujet qui met au défi la méthodologie de la criminologie comme discipline.
 Publié 26 Août 2015
Publié 26 Août 2015Ventes d’espèces protégées dans le commerce Afrique-Chine
Hors du braconnage et du trafic, le commerce "légal" apparaît tout autant comme l’une des principales causes d’extinction des espèces sauvages.
 Publié 01 Juillet 2015
Publié 01 Juillet 2015Trafic d’ivoire : lorsque les enjeux géopolitiques nourrissent les trafiquants
Face à un commerce illégal grandissant, les institutions internationales se montrent parfois peu désireuses de froisser les sensibilités.
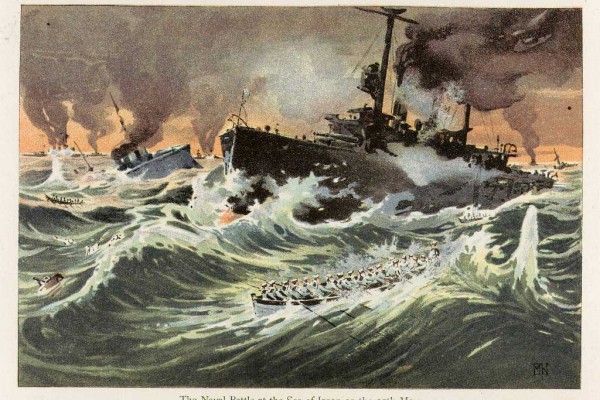 Publié 02 Juin 2015
Publié 02 Juin 2015L’onde de choc de la bataille de Tsushima en 1905
Il y a 110 ans, le 27 mai 1905, l’annonce de la défaite russe devant le Japon a galvanisé les peuples en Asie, au Proche-Orient et en Afrique.
 Publié 29 Mai 2015
Publié 29 Mai 2015Bars chinois et prostitution à Bamako : mythes et réalité
Dans la capitale malienne, les bars chinois sont souvent décriés pour les mauvaises raisons ; ou quand le journalisme s’égare.
