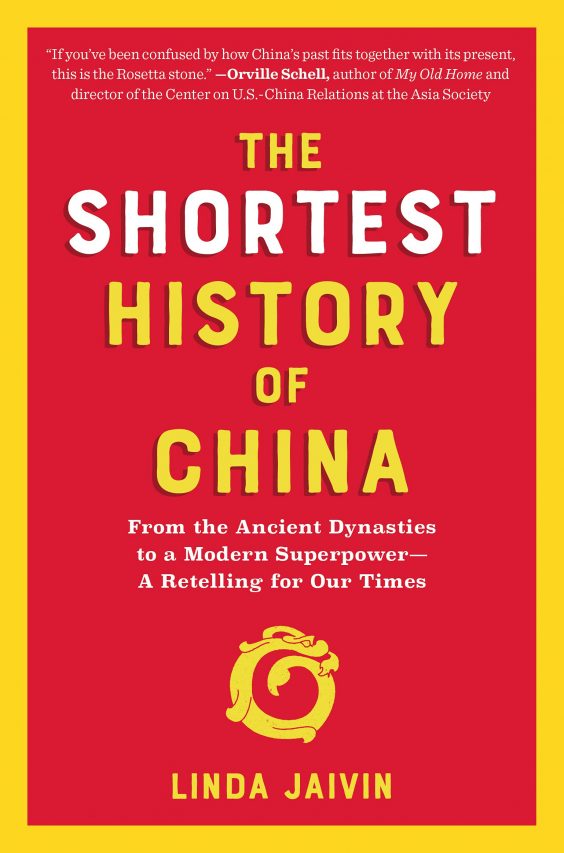Chine : la "plus courte" leçon d'histoire selon Linda Jaivin

Entretien
Australienne d’origine américaine, auteure d’une douzaine de livres et notamment de best-sellers, Linda Jaivin est aussi traductrice du chinois, essayiste et dramaturge. Née à New London, dans le Connecticut, d’une famille juive, ses deux grands-pères étaient des réfugiés de la Russie tsariste qui avaient émigré en Argentine et aux États-Unis. Sa curiosité pour la Chine la conduit à suivre des études chinoises à l’Université Brown à Rhode Island. Elle s’installe ensuite à Taïwan en 1977 pour approfondir sa connaissance de la culture et de la langue chinoises.
En 1979, Linda Jiavin déménage à Hong Kong pour son premier emploi, éditrice à l’Oxford University Press. Elle devient par la suite correspondante du magazine Asiaweek, aujourd’hui disparu. C’est alors qu’elle rencontre le chercheur australien spécialiste de la Chine, Geremie Barmé, qu’elle épouse un peu plus tard. Le couple s’installe à Canberra en Australie en 1986. Divorcée de Geremie en 1994, Linda vit depuis à Sydney. Son dernier ouvrage, The Shortest History of China, paraît en septembre 2021 aux Éditions The Experiment. Elle est également l’auteure de romans érotiques.

Extraits
Voici quelques extraits du livre de Linda Jaivin, The Shortest History of China, ouvrage de 277 pages décliné en quinze chapitres. Les trois derniers sont les plus intéressants puisqu’ils couvrent la période qui s’étend des années de règne de Mao Zedong (pages 184 à 211) à celle de Xi Jinping, arrivé au pouvoir en 2012 (pages 236 à 252).
« En décembre 1949, Chiang Kaï-shek se replie à Taïwan avec Soong Mei-ling, quelque deux millions de soldats et des fidèles, emportant avec lui 600 000 pièces d’art provenant du trésor du Palais impérial à Pékin. Les nationalistes du Kuomintang avaient réussi s’emparer de nombreux objets précieux qui sont aujourd’hui exposés au Musée national de Taipei. […]
« En 1958, Mao Zedong décide que la Chine est prête pour s’engager dans un « Grand Bond en Avant » vers une société communiste. L’organe du Parti communiste, le Quotidien du Peuple, lance un appel à la population chinoise pour « s’engager corps et âme » et « viser plus haut » pour doubler la production agricole et industrielle en 1958, la doubler encore une fois en 1959. De la sorte, la République Populaire de Chine dépasserait la Grande-Bretagne et rattraperait l’Amérique. […] Mais la production agricole et industrielle s’étaient effondrées. […] La famine s’est rapidement répandue, tandis que des informations faisaient état de scènes de cannibalisme dans de nombreux endroits des campagnes chinoises. […] Sur une période de trois ans à partir du lancement du Grand Bond en Avant, des millions de Chinois périrent. […]
« En mars 1959, la tension est soudainement montée lorsque les commandants de l’Armée populaire de libération stationnée à Lhassa ont invité le Dalaï-lama à se rendre dans leur quartier général, précisant qu’il devait venir seul. Craignant que ce dernier soit enlevé, 300 000 Tibétains entourèrent sa résidence, le Norboulinka, afin de le protéger. Le Dalaï-lama prit alors la fuite vers l’Inde tandis que l’armée chinoise se mit à bombarder le Nurboulinka, tuant des milliers de Tibétains qui se massaient à l’extérieur. Des centaines de milliers de Tibétains ont perdu la vie entre 1959 et 1961, soit de famine ou du fait du soulèvement tibétain à Lhassa, un événement connu à l’extérieur de la Chine sous le nom de nom de « soulèvement tibétain ». […]
« En août et septembre 1966, les Gardes rouges ont tué ou conduit au suicide près de 18 000 personnes dans la seule ville de Pékin. Le cadavre du célèbre écrivain Lao She a été retrouvé flottant dans un lac un jour après qu’il a été soumis à une « séance de lutte » brutale dans les locaux du Collège impérial de Pékin fondé par Kubilaï Kahn. Cette « séance de lutte » avait pris place devant 10 000 spectateurs dans le Stade des Travailleurs. Il était mort peu après sous les coups dans sa cellule en prison. Deng Xiaoping a lui aussi été soumis à ces mêmes « séances de lutte », dépouillé de toutes ses responsabilités et exilé à la campagne pour y être soumis un cette tristement célèbre « rééducation ». […]
« Mao Zedong et Lin Biao exhortent les Garde rouges à détruire les « Quatre Vieilleries » : la vieille façon de penser, les traditions, la culture et les habitudes. Un ancien Garde rouge se souvient : « Tout comme une armée de Rois Singes désireux de semer le chaos sous le Ciel. À travers le pays, ils ont détruit des mosquées, des églises, des temples taoïstes et bouddhistes, et des statues religieuses, y compris celles de l’Empereur Jaune. Ils ont torturé des croyants. Ils ont vandalisé les tombes des jésuites Mateo Ricci et Schall von Bell, celle de l’empereur des Ming Wanli. Ils ont attaqué les femmes portant le qipao ou avec des visages maquillés et ont détruit tout, des meubles de style Ming jusqu’aux traductions de romans occidentaux. Ils ont changé les noms de rues ou de places pour les remplacer par des slogans révolutionnaires », suscitant une grande confusion avec des noms tels que « s’opposer à l’impérialisme », « libération » dans une même ville. […]
« En 2016, le PCC a déclaré que Xi Jinping était « un dirigeant de premier plan », un qualificatif qui avait été auparavant accordé à Mao, Deng et Jiang Zemin. Ce qualificatif signifie un rang dominant qui rend difficile de critiquer ses décisions. Plus tard, le PCC a amendé sa Constitution pour adopter « La pensée Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une Nouvelle ère comme son idéologie ». À ce stade, Xi avait accumulé tant de titres officiels, y compris celui de commandant en chef du nouveau Centre de commandement des opérations de l’Armée populaire de libération, que son surnom était devenu celui de « Président de tout ». Si ce qualificatif rappelle Hongwu, l’empereur des Ming qui insistait sur sa volonté de centraliser le pouvoir dans ses mains, Xi s’est propulsé dans un âge d’or tout comme l’empereur Qianlong, celui de la puissance culturelle et militaire. […]
« La tenue annuelle de l’Assemblée nationale populaire donne lieu à l’organisation d’une parade de Tibétains, Ouïghours et d’autres minorités ethniques dans leurs costumes colorés. Mais la politique ethnique de l’État est devenue de plus en plus coercitive et visant à l’assimilation, mettant en avant le fait que la nationalité « chinoise » prend le dessus sur l’origine ethnique. Rendre prioritaire l’usage du putonghua (chinois mandarin) sur l’utilisation des langues indigènes dans les écoles, les courants migratoires de Han, l’interdiction des pratiques religieuses et la montée de la surveillance et du contrôle ont suscité un mécontentement croissant dans les régions telles que le Xinjiang, le Tibet et d’autres zones. Au Xinjiang, à la suite d’une série d’incidents violents entre les Ouïgours et les Hans et des attentats terroristes isolés commis par des militants en faveur de l’indépendance des Ouïghours, le gouvernement chinois a renforcé sa présence militaire de même que son contrôle et sa surveillance dans cette région. À partir de 2017, l’État a commencé à interner un million ou davantage de Ouïghours, Kazakhs et d’autres minorités de confession musulmane, certains pour le seul fait de porter la barbe, posséder un exemplaire du Coran ou d’avoir trop d’enfants, un phénomène qui s’est traduit par la construction de centaines de camps d’internement. Des témoignages de survivants ou de membres de leurs familles parvenus en Occident décrivent des cas de torture, de refus de donner des aliments, de retrait d’enfants, de travail forcé et d’actes de cruauté gratuite tels que la consommation forcée de viande de porc et d’alcool que les avocats des droits humains estiment relever d’un génocide culturel. Des milliers de mosquées et de temples ont été détruits et remplacés par des bars et des magasins. Pékin parle lui de « centres de formation professionnelle » et de « déradicalisation ». Il rejette toutes les accusations de violation des droits humains et soutient que le revenu par tête au Xinjiang (en 2018, il était trois fois supérieur à celui de l’Inde) est la preuve de la « protection des droits humains ». […]
« La seule façon d’apprendre l’Histoire est d’étudier l’Histoire. Des voies diverses et des récits concurrents sont inévitables pour raconter une histoire aussi longue que celle de la Chine. Le PCC préfère rester simple, fait usage de l’histoire pour se montrer comme le dirigeant légitime de cette ancienne nation. Mais comme l’a écrit l’historien de la dynastie des Song Sima Guang, « prêtez attention à toutes les parties si vous voulez connaître l’illumination ; reposez-vous sur l’une d’entre elles si vous souhaitez rester dans l’obscurité. Et il n’existe pas de lieu plus obscur qu’une maison de fer ». »
Soutenez-nous !
Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.
Faire un don