Roman : "Les Vents noirs" d’Arnaud de La Grange, de la Sibérie au Xinjiang
Contexte
Si Arnaud de La Grange se défend dans cet entretien d’avoir voulu écrire un roman historique, Vents noirs nous offre néanmoins une plongée au cœur de deux empires rongés par la guerre civile. Un entre deux temps – deux guerres mondiales -, et un entre deux mondes – l’orient et l’occident – où les causes semblent plus désespérées les unes que les autres. Lancée en novembre 1917 par Lénine, la révolution russe va ensanglanter jusqu’aux neiges de Sibérie. Les bolcheviks y sont encore très minoritaires et la conquête des villages et des villes tourne au massacre. Même chose dans ce Far West chinois appelé alors le Turkestan oriental, devenu aujourd’hui la région autonome ouïghoure du Xinjiang. C’est peut-être d’ailleurs, pour les passionnés d’Asie que nous sommes, les pages les plus prenantes de ce premier roman.
2 fois et demie grand comme la France, le Xinjiang est alors en proie à la rébellion des seigneurs de la guerre et à une population à majorité musulmane remontée contre le pouvoir chinois. Face à cela, Pékin mène une politique à la fois répressive et isolationniste qui n’a fondamentalement pas changé depuis l’avènement de la Chine nouvelle de 1949. Outre cet aspect historique, la force de ce premier roman tient dans ses parties descriptives. Le réalisme de certaines scènes de batailles dans les steppes sibériennes vous glacera le sang. Les descriptions des oasis interdites chinoises et l’ascension des monts du ciel vous enchanteront, avant que le récit ne vous ramène à la réalité de l’action.
Dans ces confins de l’Extrême-Orient, un jeune officier français, lui-même en pleine crise existentielle, doit arrêter un archéologue au bord du gouffre. Toute ressemblance avec des personnages ou des situations ayant existé n’est pas forcément fortuite. L’auteur confie avoir été inspiré par la vie extraordinaire du linguiste, sinologue, tibétologue, explorateur puis attaché militaire, Paul Pelliot. En piochant sur les étagères, on songe aussi à Giovanni Drogo chez Buzzati, à Aldo et Marino chez Julien Graq et évidemment à Marlow et Kurtz chez Conrad. On le sait en ouvrant le roman : la mission du lieutenant Verken ne peut nous mener qu’au « cœur des ténèbres ». Comme les personnages du récit, nous nous retournons quasi à chaque page pour tenter d’apercevoir les nuages de poussières des poursuivants. En espérant que ces derniers laisseront un peu de répit à la caravane en déroute, pour que vive l’aventure jusqu’au bout.
« De l’extérieur, le train avait des allures de gros scarabée. Noir, hérissé de pinces et d’antennes. Sur l’avant, à l’arrière, sur les flancs, de tous côtés, des canons pointaient à travers la tôle. Trapus, courts, une large gueule noircie. Mauvais comme des chiens de rue. On les sentait prêts à aboyer sur qui passait à leur portée. (…) L’ouvrage aurait pu sortir d’un extravagant cerveau, destiné à épater les badauds d’une exposition universelle. Une volée d’obus de bon poids n’aurait pas fait grand cas de ces minces tôles, soutenues par quelques madriers. Mais cette cotte d’acier suffisait à protéger des piqûres d’armes légères. Surtout, elle impressionnait. Le but était bien là. Cogner sur les âmes, frapper d’effroi. » (extrait des Vents noirs)
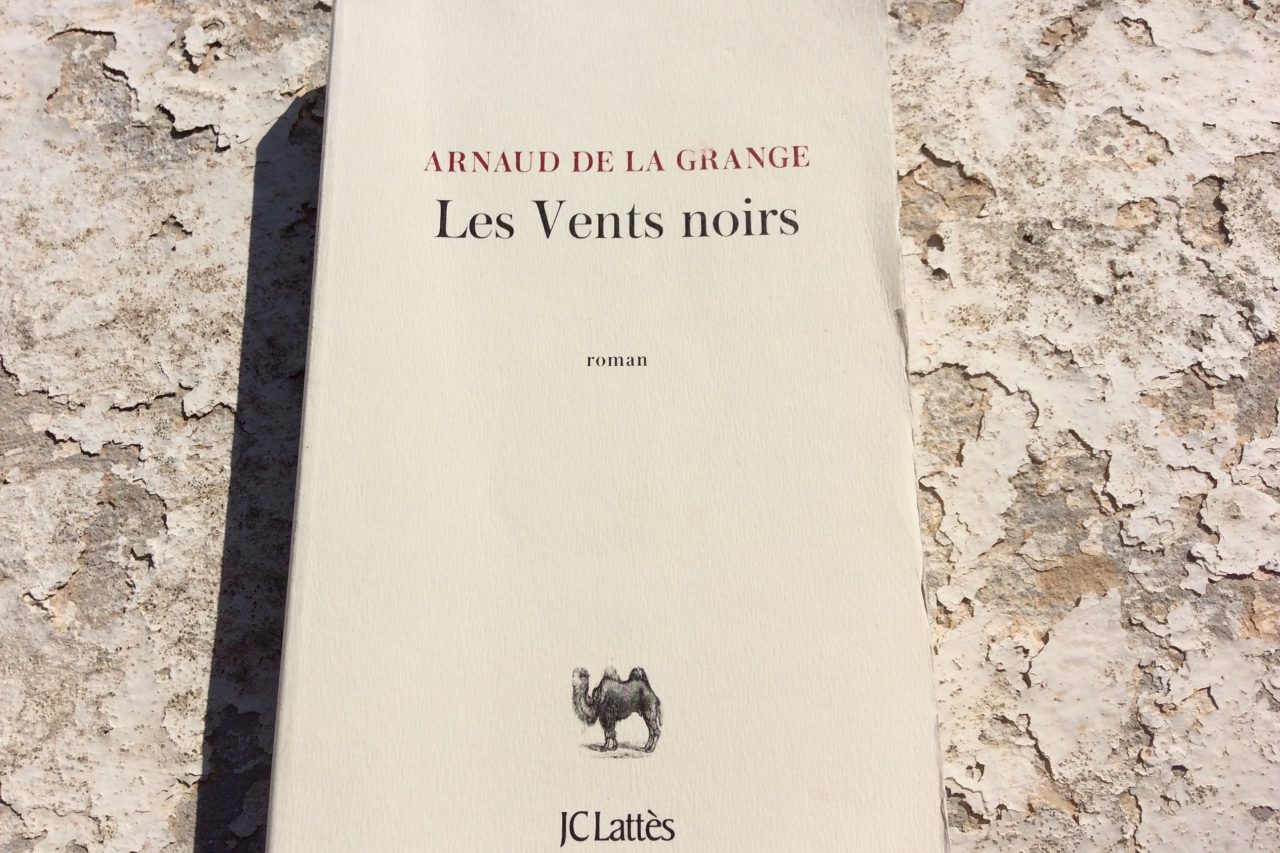
« Ne m’en veuillez pas, jeune homme, mais je doute que vous preniez la mesure du personnage. Thelliot n’est pas un savant comme les autres. C’est un ogre, un boulimique de savoirs ! Mû par une curiosité intellectuelle inextinguible ! Il se joue des frontières entre les disciplines, entre les aires culturelles. » Le Vietnam, la Chine, les études tibétaines, turques, mongoles ou iraniennes, il a touché à tout. En laissant à chaque fois sa marque. Les dizaines de milliers de manuscrits qu’il a ramenés à Paris ont révolutionné l’histoire de la Chine médiévale et la connaissance de ses échanges avec l’Inde, l’Asie Centrale. Il est le premier occidental a avoir pu traiter d’égal à égal avec les grands lettrés chinois. Ce n’est pas derrière un homme que vous courrez, mais après une légende… » (Extrait des Vents noirs)
« La guerre, alors, devint de plus en plus sale. Elle prit le visage grêlé des escarmouches. Les adversaires se tuaient par surprise et jamais ne se laissaient la vie. C’était désormais une affaire d’irréguliers. Aucune règle ne valait plus. Verken avait préparé ses hommes à cela. Ils avaient tailladés l’extrémité des balles de leurs fusils, afin de les rendre plus meurtrières. Les vêtements restaient volontairement salis. L’acier des sabres et des armes à feu était laissé à la corrosion, pour éviter les reflets alertant l’œil ennemi. Ils avaient même abandonné derrière eux les chevaux gris clairs, ne gardant que ceux dont la robe sombre n’attirait pas le regard. » (Extrait des Vents noirs)
Soutenez-nous !
Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.
Faire un don



