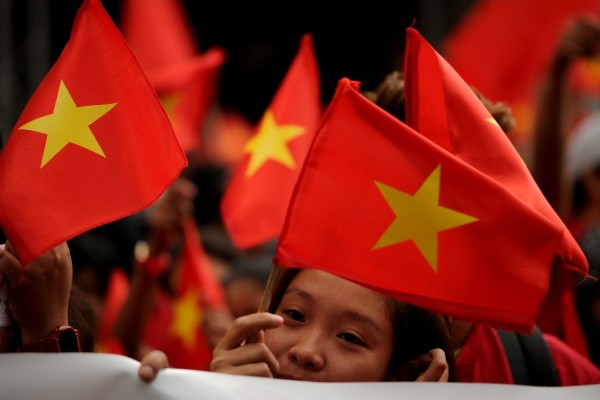Entretien
"Le Ministère du Bonheur Suprême" d'Arundhati Roy : l'Inde en un millier d'histoires

L'écrivaine indienne Arundhati Roy. (Source : Grazia)
Le Ministère du Bonheur Suprême incarne ces romans que nous n’attendions plus. Ces vingt dernières années, l’auteur indienne Arundhati Roy s’est illustrée par ses combats. Essais après essais, elle déplore, infatigable, la montée d’un nationalisme hindou, milite pour l’indépendance au Cachemire, lutte contre la discrimination envers la caste des Intouchables et s’engage contre les essais nucléaires indiens. Autant de luttes qui semblent éclipser la romancière, auteur du succès planétaire Le Dieu des Petits Riens, publié en 1997. Pourtant se préparait dans l’ombre une deuxième fiction intitulée Le Ministère du Bonheur Suprême publiée chez Gallimard en janvier dernier. Nourrie sans nul doute de ses nombreux combats, Arundhati Roy y offre une mosaïque de l’Inde moderne sans avoir rien perdu de son imagination et de ses talents de conteuse.
Le Ministère du Bonheur Suprême débute dans la vieille-ville de Delhi, un soir d’hiver, avec la naissance d’Aftab. Le jeune garçon deviendra Anjum, une musulmane transgenre ou plutôt une Hijra, qui signifie en ourdou « une âme sainte prisonnière d’un corps inadéquat ». Elle vit plusieurs années au sein d’une communauté d’Hijras avant de s’installer dans un cimetière de New Delhi. Elle le transforme en maison d’hôtes pour les laissés-pour-compte et fait de ce lieu morbide un endroit résolument vivant. Le destin d’Anjum est lié à celui de Tilottama, une jeune graphiste amoureuse d’un militant indépendantiste cachemiri.
Elle va se retrouver en plein coeur du conflit au Cachemire, où « les cimetières deviennent chose aussi courante que les parkings ». Car la grande Histoire rattrape à sa façon chacun des personnages. Ils sont pris au milieu de la répression musulmane dans l’État du Gujarat en 2002, victimes de l’explosion d’une usine à Bhopal en 1984 ou encore mêlés à la rébellion maoïste au Bastar. Arundhati Roy dissémine ces épisodes tout au long du roman, non sans une pointe de cynisme.
Elle offre ainsi, en décousu, vingt ans de l’histoire de l’Inde à travers une myriade étourdissante de personnages. Les histoires d’Anjum et de Tilottama se mêlent à celle d’un imam aveugle, d’un intouchable qui se fait appeler Saddam Hussein, d’un membre des services de renseignements indiens, d’un simple cordonnier, d’un bébé abandonné sur un trottoir, ou encore d’un activiste en grève de la faim depuis onze ans. Certains personnages n’apparaissent que pendant une dizaine de pages. D’autres disparaissent avant de réapparaître quelques chapitres plus loin. La narration est tordue, faites de tours et de détours, parfois chaotique mais toujours vivante, à l’image des ruelles du vieux Delhi. « Comment écrire une histoire brisée ? En devenant peu à peu tout le monde. Non. En devenant peu à peu tout. » Cette phrase, en quatrième de couverture, résume bien les intentions d’Arundhati Roy.
Il faut s’accrocher et persévérer dans ce fourmillement d’histoires. Les digressions traînent parfois en longueur et on peut se surprendre à vouloir sauter quelques paragraphes, perdus dans les noms hindous, ourdous ou musulmans. Cependant, une fois les cent dernières pages atteintes, alors que les rouages s’imbriquent entre eux, le plaisir redouble. Nous prend alors l’envie de recommencer au début pour se perdre encore dans l’Inde d’Arundhati Roy. L’écrivain-militante a réussi à offrir ce que tous ceux qui ont aimé Le Dieu des Petits Riens espéraient : un livre à la fois épique mais intimiste, tendre et violent, critique mais poétique. Un plaidoyer pour l’amitié dans une Inde pleine de contradictions. Cela méritait d’attendre.
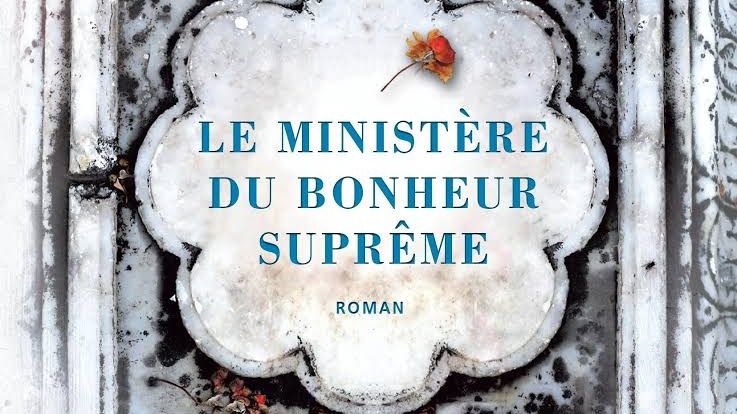
Entretien
Pourquoi avoir attendu si longtemps pour publier un second roman ?
Arundhati Roy : Quand j’ai écrit Le Dieu des Petits Riens, je suis rapidement devenue célèbre. Au même moment, un gouvernement d’extrême-droite hindou-nationaliste est arrivé au pouvoir en Inde et a immédiatement commencé à faire des essais nucléaires. On a alors progressivement assisté à un changement du discours politique. Des choses sont devenues acceptables à dire en public alors qu’elles ne l’étaient pas avant. Sans le vouloir, je suis devenue un des visages de cette Inde moderne. Cela me semblait inacceptable : j’étais en profond désaccord avec ces gens qui m’encensaient. C’est pour cela que j’ai écrit un essai qui s’appelle La fin de l’imagination. Cela a changé mon parcours d’auteur et le type d’écrivain que je suis devenue. Après Le Dieu des Petits Riens, j’ai donc décidé de passer du temps à voyager dans ce pays pour comprendre où je vivais.
A cela s’ajoute le fait que j’étais mal à l’aise : c’est étrange de vivre comme écrivain reconnu dans un pays où beaucoup de gens ne peuvent pas lire. Il y a pour moi une grande différence entre la fiction et mes essais. Dans la non-fiction, on intervient dans une situation sans issue et on essaie d’apporter un débat. Dans la fiction, on se laisse entraîner dans un monde plus complexe. On partage une vision du monde en la construisant sur la page. C’est un acte d’amour plutôt qu’un acte de colère.
Le récit débute avec l’histoire d’Aftab, un jeune garçon qui devient Anjum, une Hijra. Comment comprendre ce statut ?
D’abord, il est important de comprendre qu’aucun personnage, ni Anjum ni les autres, n’est un symbole qui représente une communauté. Ce sont des individus, pas des concepts. Anjum naît Aftab dans une famille musulmane chiite du vieux quartier de New Delhi. À sa naissance, sa mère réalise que ce n’est pas vraiment un garçon… C’est une Hijra, « une âme sainte prisonnière d’un corps inadéquat ». Aftab, enfin Anjum, va déménager vers 15 ans, pas très loin, dans une Khwabgah, un terme qui signifie « la maison des rêves » en ourdou, où vit une communauté très bien organisée de Hijras.
Chacun des personnages du Ministère du Bonheur Suprême à une frontière intérieure en lui. Il n’a pas qu’une caractéristique. Anjum n’est pas qu’une Hijra, elle est aussi une chanteuse et une musulmane. Dans l’Inde moderne, c’est d’ailleurs plus dangereux d’être musulmane que Hijra… En 2002, alors qu’Anjum a la quarantaine, elle est prise au piège dans le massacre des musulmans au Gujarat. Or, c’est parce qu’elle est musulmane qu’elle est prise dans ce massacre, pas parce qu’elle est Hijra. Par contre, elle en réchappe parce qu’elle est Hijra et qu’en tuer une porte malheur. C’est d’ailleurs cet épisode qui va l’amener à quitter la Khwabgah pour s’installer au cimetière où elle monte une maison d’hôtes. Je tiens à préciser que ce n’est pas du réalisme magique comme on le dit parfois. Ce n’est pas le fruit de mon imagination : en Inde, les cimetières sont des ghettos de musulmans. Les hindous n’ont pas de tombe puisqu’ils pratiquent la crémation mais des musulmans viennent vraiment y vivre.
Votre roman ressemble en réalité à plusieurs romans : comment l’avez-vous conçu ?
Pour moi, la façon dont une histoire se dévoile est aussi importante que l’histoire elle-même ! Cela vient peut-être de la vie que j’ai vécu et des différentes choses que j’ai écrit ces vingt dernières années. J’ai énormément d’attentes vis-à-vis du roman : je ne peux pas me contenter d’avoir une bonne histoire et une belle langue pour la raconter. En écrivant ce roman, je suis partie d’un premier constat : je vis à Delhi et tous les jours, je passe d’une langue à l’autre. Delhi est une ville qui existe dans plusieurs langues différentes. Se pose donc la question de comment écrire quelque chose en une langue alors qu’elle été imaginée en plein de différentes. J’ai aussi l’impression que la forme romanesque est domestiquée. On écrit tous la même chose que l’on sait vendre en trois phrases aux éditeurs. Or pour moi, le roman doit être sauvage. Il doit être un chaos construit. Le roman ne doit pas avoir peur d’aborder la politique comme l’intimité. Il faut prendre des risques. J’en suis venue à la conclusion que le lecteur ne pourra peut-être pas lire mon roman. Il doit apprendre à le connaître en se perdant dedans. Dans Le Ministère du Bonheur Suprême, tous les personnages ont un nom, même les plus insignifiants. Quand on se promène dans une grande ville, c’est la même chose. Quand on croise un cordonnier, il a une histoire. Vous pourriez vous asseoir et fumer une cigarette avec lui et essayer d’en savoir plus. C’était mon défi. Je ne voulais pas créer un produit à consommer : quand il est lu, c’est terminé.
Le conflit au Cachemire est un thème important de votre ouvrage, quels messages souhaitiez-vous transmettre à vos lecteurs ?
Depuis dix ans, le conflit au Cachemire a fait des milliers de morts. Tout le monde le sait. De façon plus intime, c’est aujourd’hui l’endroit où l’occupation militaire est la plus dense au monde. Je m’interroge sur ce que cela fait de vivre dans un endroit qui est occupé militairement depuis tant d’années et où même les questions de trafic routier sont gérées avec des mitraillettes. Quel est l’impact sur l’esprit des gens quand il y a un tel contrôle et quand on nous ment en permanence ? Les Indiens sont obsédés par le fait qu’ils vivent dans la plus grande démocratie du monde mais ils taisent et supportent les violences de caste et les violences qui ont lieu au Cachemire. Comment peut-on vivre avec ça ?
Biblap est employé libéral au Bureau des renseignements indiens. Il semble un peu à l’opposé de vos convictions et même de vos combats. Pourtant, c’est le seul à parler à la première personne. Pourquoi ?
Je ne sais pas, cela a été un véritable choc pour moi ! Le personnage de Biblap est de caste et de classe supérieures. C’est effectivement un officier du service de renseignement. Il est la voix de l’État indien même s’il est plutôt proche des idées de Nehru, à la fois laïques et fondamentalement violentes. C’est peut-être parce qu’il représente l’État qu’il arrive à prendre le pouvoir et donc la parole. J’ai essayé de le faire parler à la troisième personne mais je n’ai pas réussi. Comme les autres personnages, il est aussi en proie à une frontière qui le traverse. C’est aussi un amoureux transi, un ivrogne qui a une piètre image de lui-même. Il ne faut pas l’oublier.
Au milieu de l’ouvrage, une scène a lieu sur la place Janthar Mantar de New Delhi. C’est à ce moment que le lien entre les différents personnages se crée. Pourquoi avoir choisi cet endroit ?
Cette scène est le centre nerveux du livre. La place Janthar Mantar de New Delhi est un endroit très important pour moi et pour beaucoup de personnes autour de moi. De nombreux mouvements politiques s’y sont rassemblés pour manifester. J’y suis moi-même allée plusieurs fois. C’est donc logique que ce soit de là que le roman se déroule. Tous ceux qui, en Inde, se sont impliqués dans des mouvements de résistance savent que dans ces mouvements, il y a beaucoup de fous. On les accueille très bien. Dans le roman, on a un personnage que j’adore qui proteste pour le compte de tout le monde. Il a une liste de demandes utopiques et interminables. C’est un personnage qui symbolise le droit à être déraisonnable. La place Janthar Mantar a été fermée ces dernières semaines par le gouvernement. Il doit penser que sans lieu d’opposition, il n’y en aura plus !
Propos recueillis par Cyrielle Cabot
Soutenez-nous !
Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.
Faire un don