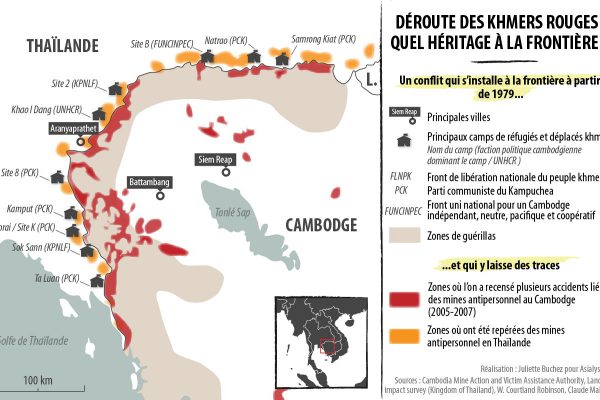Thaïlande : Banharn Silapa-archa, incarnation de la "money politics"

Banharn a incarné le monde politique thaïlandais d’une certaine époque, celle des années 1990 lorsque le pays, sorti du régime de paternalisme autoritaire du général Prem Tinsulanonda (Premier ministre de 1980 à 1988) s’est jeté dans les bras des politiciens affairistes et, disait-on, corrompus. Souvent, il s’agissait de parrains de province qui, pour les plus habiles, avaient réussi à convertir leur pouvoir local au niveau national. A l’origine, Banharn est un homme d’affaires provincial qui a réussi dans le secteur de la construction à Bangkok grâce à son habileté à établir des connexions avec les bureaucrates et les politiciens détenteurs des budgets publics.
Après la « révolte du 14 octobre 1973 » contre la dictature militaire de Thanom Kittiakachorn, le roi Bhumibol Adulyadej l’inclut au sein d’une Assemblée chargée de remettre le pays sur de bons rails après seize ans de despotisme en uniforme. Banharn s’y distingue par son pragmatisme, son entregent et la sympathie naturelle qui se dégage de sa personne. A Suphanburi, il devient un personnage incontournable, d’abord utilisant des moyens financiers pour consolider sa popularité, puis rapidement adulé par la population.
Hommes d’affaires politiciens et agents électoraux
Selon le système de la « money politics », le politicien désormais devenu parlementaire de sa province récupérait sa mise en prélevant des commissions sur les contrats de travaux publics (routes, bâtiments administratifs, ponts…) qu’il avait désormais tout loisir de conclure avec des hommes d’affaires de son clan. Rien de nouveau sous le soleil : Fernandel avait brillamment illustré ce procédé dans « Le Schpountz » réalisé par Marcel Pagnol (1938).
Mais Banharn avait, d’une certaine manière, transcendé ce système. « Banharn mange, mais recrache », disaient crûment de lui les habitants de la province de Suphanburi, signifiant par là que s’il prélevait son pourcentage, il prenait aussi soin de sa province, à tel point que beaucoup l’avaient rebaptisée « Banharn-buri », la dotant de routes à quatre voies, d’agréables parcs urbains, et même de musées et de zoos. On disait de lui avec une nuance d’admiration qu’il était incomparable pour « sucer le budget national ».
Bien d’autres parrains de province entrés en politique, comme Montree Pongpanich à Ayutthaya, Snoh Thientong à Sah Keo et Wattana Asavahame à Samut Prakarn, étaient loin d’avoir la même popularité, même s’ils étaient craints. La forte émotion ressentie à Suphanburi, une province très rurale il y a vingt ans, mais aujourd’hui semi-urbanisée et peuplée de ce que le politologue australien Andrew Walker a qualifié de « political peasants », témoigne de l’attachement des gens de la province pour Banharn.
Le régne du parrain de Suphanburi n’était pas sans excès. L’étrange tour Banharn-Jumsai (Jumsai est le nom de la femme de Banharn) érigée comme un énorme phare incongru dans le centre de la capitale provinciale pouvait faire sourire. On peut même y visiter un musée tout entièrement dédié à la gloire de Banharn et où sont exposés sous vitrine ses portraits de famille et son casque de chantier.
Un mandat marqué par le désastre bancaire
Humilié, Banharn dut quitter le poste de Premier ministre en septembre 1996. Mais d’une certaine manière, l’enfant de Suphanburi, dont le père était venu du sud de la Chine au tout début du XXème siècle et avait épousé une Siamoise, avait réussi son coup, entre une enfance passée dans l’épicerie chinoise familiale et les couloirs du pouvoir de la capitale.
Soutenez-nous !
Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.
Faire un don