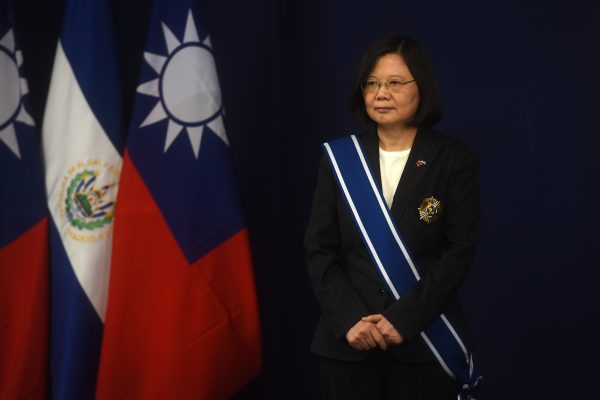Taïwan : le massacre du 28 février ou la naissance d'une nation ?
De tragiques méprises
Les chiens remplacés par les cochons (1)
Le feu aux poudres
Une mémoire collective coupée de la Chine
On peut dire aujourd’hui que la façon avec laquelle les nationalistes chinois ont géré la prise de contrôle de Taïwan a largement participé à renforcer le sentiment national sur l’île en provoquant une forte adversité entre Taïwanais et Chinois. En somme, le pouvoir exercé par les Chinois de la ROC sur Taïwan a activement œuvré à la perte d’identification des Taïwanais envers la Chine.
Le fait même que la mémoire de tels événements ait refait surface avec la démocratisation aurait d’ailleurs dû alerter Pékin. Le PCC devrait prendre bonne note que menacer les Taïwanais de tensions militaires ou de représailles économiques pour leurs choix démocratiques n’engendrera que leur éloignement. Il réveillera chez les Taïwanais les douleurs datant des agissements peu avouables d’un précédent pouvoir chinois, tout aussi autoritaire et imperméable aux souhaits des insulaires.
Note (1) : il s’agit ici de la traduction par l’auteur de « Dogs go, Pigs come », une expression taïwanaise utile pour éclairer la colère que les Taïwanais entretenaient à l’égard des Chinois. Elle visait à l’origine à établir un lien de descendance entre les pouvoirs japonais et chinois sur Taïwan, perçus tous deux comme prédateurs. Source: Goldstein, p.14.
Soutenez-nous !
Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.
Faire un don