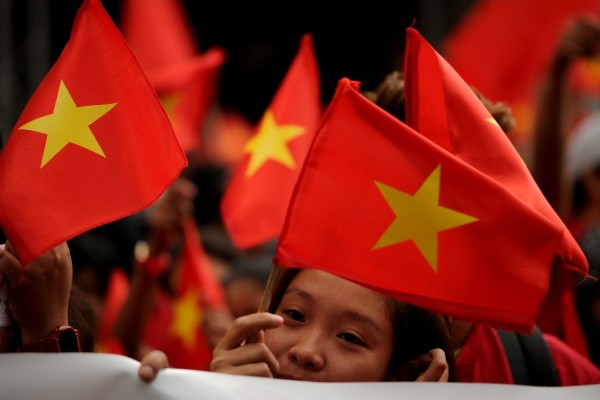Japon : que sont devenues les tayû de Kyôto, ces courtisanes de premier rang ?
Contexte
En 1589, le seigneur Toyotomi Hideyoshi autorisa pour la première fois l’instauration, à Yanagimachi, d’un yûkaku, c’est-à-dire un quartier fermé où se concentraient des maisons de courtisanes. Après un premier déménagement, il fut une nouvelle fois déplacé en 1641, à Shimabara, dans la ville de Kyôto. Au XVIIIe siècle, le quartier est devenu un lieu de sociabilité. Très cultivées, les tayû discutaient ainsi avec des intellectuels, tout en les distrayant par la musique, le chant ou encore la danse. Au début du XIXe siècle, Shimabara ne fit bientôt plus le poids par rapport au quartier de Gion, où les geiko (appellation des geishas à Kyôto) vendaient aussi leurs arts d’agrément.
Il n’existe de nos jours plus que cinq tayû à Kyôto, dont l’une, affaiblie par l’âge, n’exerce plus vraiment. Tsukasadayû, dans le métier depuis trente-et-un ans, appartenait jusqu’à récemment à la maison Wachigaiya. Mais, avec sa fille Aoitayû, devenue tayû en novembre 2014, elles sont devenues indépendantes en 2015. Les deux femmes ont alors créé leur propre maison, Suehiroya, et ont déménagé du quartier de Gion à celui de Shimabara. Heureux retour aux sources.
Les débuts de Tsukasadayû
Ni prostituées, ni geishas
Également distinctes des geishas, les tayû ont toutefois en commun la nature de leur métier : toutes deux artistes, elles divertissent les clients par des spectacles de danse et de musique, leur conversation et l’organisation de jeux. Elles font aussi durer la pratique millénaire, pourtant abandonnée depuis l’ère Meiji (1868-1912), de se colorer les dents en noir. « Nous sommes les seules à conserver cette tradition », confie Tsukasadayû, quelques maiko y ayant aussi recours juste avant de célébrer leur passage au statut de geiko. « À l’époque, toutes les personnes qui fréquentaient le palais se noircissaient les dents, car on considérait qu’il était indécent de les montrer. Plus tard, la pratique s’est appliquée aux seules femmes mariées », explique Aoitayû. Si les gens conservaient cette couleur pendant plusieurs semaines, les tayû se démaquillent aujourd’hui après leur spectacle. « Mais parfois, j’oublie d’enlever cette cire noire après une représentation », confie Tsukasadayû en riant.

« Par ailleurs, les instruments utilisés aujourd’hui ne sont pas les mêmes : en plus du shamisen, les tayû, au contraire des geishas, jouent également d’instruments plus anciens comme le biwa [luth] ou le koto [cithare] », souligne Tsukasadayû. Il existe bien d’autres particularités, telles que la ceinture de kimono, qui se porte derrière chez les geishas et devant chez les tayû, ou la chevelure de ces dernières, bien plus extravagante. Il faut dire qu’avec une perruque de quatre kilos, décorée d’une vingtaine de longues épingles richement décorées, elles passent difficilement inaperçues.
Une clientèle variée, de plus en plus féminine
Si dans d’autres lieux, la clientèle est réduite à certaines catégories socioprofessionnelles, comme les médecins ou les chefs d’entreprise, celle des tayû est plus variée. « Nous recevons pas mal d’artistes, surtout issus de la culture traditionnelle, mais aussi des gens du cinéma », confie Tsukasadayû. « Les seuls personnes qui ne viennent pas ici sont les assassins », s’amuse à souligner Aoitayû. « Mais on voit quand même des « tueurs de cœur », des séducteurs », plaisante Tsukasadayû.

La folie des touristes
« Un jour, nous avons appelé deux taxis pour nous rendre à un repas solennel. Je portais mes vêtements d’apparat et m’apprêtais à monter dans la voiture en compagnie d’une jeune apprentie et de sa mère, quand j’ai aperçu au loin un groupe d’une trentaine de personnes s’approcher en courant, raconte Aoitayû. J’ai eu très peur et j’ai tout de suite senti le danger. Nous sommes rapidement entrées dans le taxi, qui n’a pas tardé à être entouré de gens, collés aux vitres et qui tentaient de prendre des photos de nous avec leur smartphone », poursuit-elle. « Quant à moi, j’ai été rapidement encerclée et j’ai dû nager la brasse avant de pouvoir grimper dans le second taxi », se souvient Tsukasadayû. « Nous avions l’impression d’être des criminelles », confient-elles toutes les deux. « Je me demande si les animaux du zoo pensent comme cela », s’exclame Aoitayû en riant.
Les tayû connaissent-elles la crise ?
« C’est un métier où on apprend beaucoup de choses, mais il faut savoir que le gagne-pain est insuffisant, témoigne Tsukasadayû. La situation est un peu meilleure chez nous, car j’ai un grand réseau de clients, que j’entretiens depuis que j’ai commencé en tant que maiko, et puis nous organisons un grand nombre d’événements. Mais une autre maison me disait qu’elle ne faisait presque plus de repas d’apparat. J’aimerais recommander cette profession aux jeunes, mais il faut être conscient de la réalité, qui est moins rose qu’on pourrait le penser. »
Soutenez-nous !
Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.
Faire un don