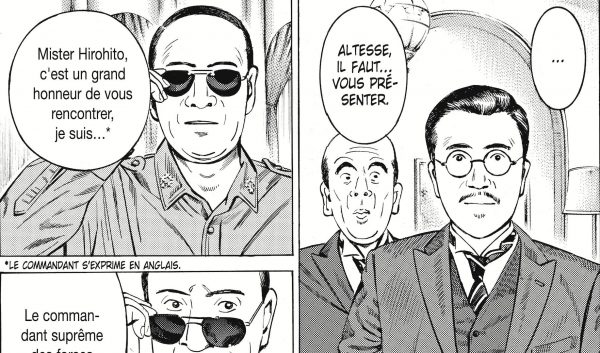Françoise Moréchand : "Le Japon, je l'ai aimé et cela m'a attiré les foudres des Japonais"

Entretien
Au Japon, cette Française est devenue une égérie. Connue sous le nom de La Gaijine (外人, « l’étrangère »), diplômée des Langues Orientales, Françoise Moréchand découvre l’archipel en 1958. Premier « tarento » (タレント), ou « talent », étranger apparue à la télévision japonaise en 1964, elle devient une star du petit écran nippon. Elle anime des émissions sur l’art de vivre à la française sur la télévision d’État NHK. Pendant cinquante ans, elle se consacre à communiquer auprès des Japonais et des Français pour faire découvrir les richesses de chacune de ces cultures. Professeur de français, écrivain à succès et auteur de nombreux livres dont La Gaïjine (1990) et Le chic c’est chic (1976, vendu à un million d’exemplaires), coordinatrice de mode, elle a dessiné des collections de bijoux, de la vaisselle et même des kimonos. Elle a aussi travaillé pour de nombreux grands groupes internationaux tels que Dior, Publicis, Chanel ou Nissan. Membre de la section Japon des Conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF), élue à l’Assemblée des Français de l’étranger pour l’Asie du Nord de 2000 à 2006, elle participe également ou a participé jusqu’à 30 comités gouvernementaux japonais, en particulier sur les thèmes de l’environnement et du vieillissement de la population. Elle est conseillère et maître de conférences au Musée d’Art contemporain du XXIème siècle de Kanazawa, chevalier de la Légion d’honneur ainsi que commandeur de l’ordre national du mérite.
fréquentent pour déjeuner entre copines.
Soutenez-nous !
Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.
Faire un don